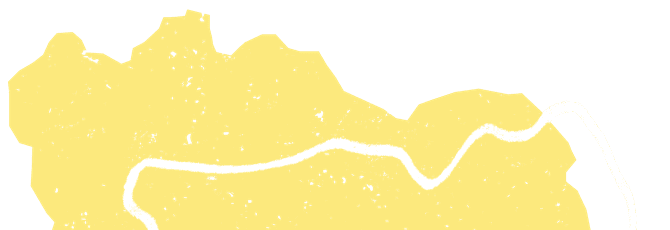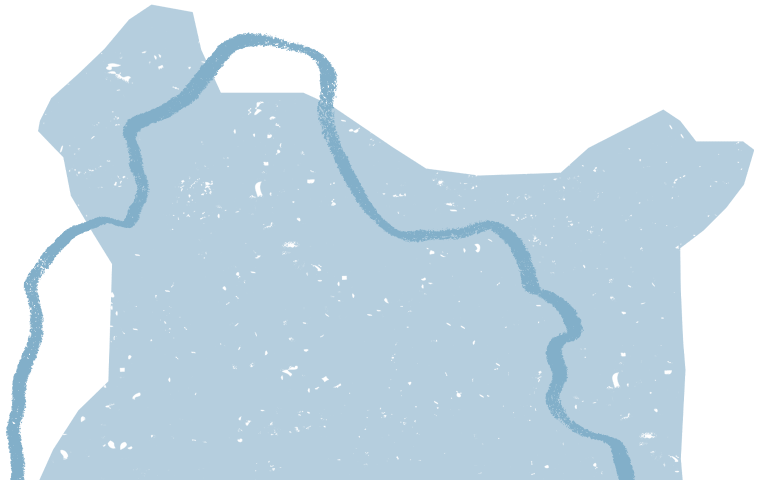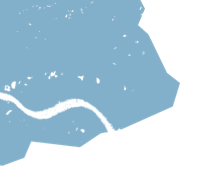En 2008, la population d’Abrik, une petite communauté qui vit dans la savane herbeuse du centre-nord du Niger, en Afrique de l’Ouest, a patiemment attendu que la pluie tombe, mais en vain. En 2009, les habitants ont à nouveau patiemment attendu que la pluie tombe, toujours en vain. Cette fois, la sécheresse était bien plus répandue et a touché l’ensemble du pays. Le nord du Sahel est toujours sec, avec seulement 250 à 300 mm de pluie par an. Pourtant, les habitants d’Abrik, et du reste du département d’Abalak où ils vivent, n’avaient pas connu de pluies abondantes depuis 2007 ! Comment allaient-ils pouvoir survivre jusqu’aux pluies de 2010 ? Comment ces éleveurs semi-nomades allaient-ils pouvoir maintenir leurs enfants et leurs animaux en vie pendant deux années de sécheresse ?
Une approche intégrée
Jeunesse En Mission Entraide et Développement (JEMED), une petite ONG chrétienne, travaille avec les éleveurs touaregs et peuls dans le département d’Abalak depuis 1990, les aidant à développer des communautés résistantes à la sécheresse. Actuellement, ils servent plus de 25 000 personnes, musulmanes et chrétiennes, à travers diverses communautés. Le travail de JEMED se base sur une approche intégrée des problèmes de développement chez les éleveurs. Celle-ci associe des éléments de l’adaptation au changement climatique, de la réduction des risques de catastrophes, de la gestion des ressources naturelles et du développement communautaire, dans le cadre d’un programme unique à présent appelé « Développement résilient », terme développé par Tearfund. En 2009, JEMED a remporté le prix Sasakawa du bureau des Nations Unies pour la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), pour son travail dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes.
Sécheresses fréquentes
Le concept de solutions résistantes à la sécheresse ou aux changements climatiques est central dans la stratégie de JEMED. Cette idée est venue des éleveurs eux-mêmes. En 1990, ils ont expliqué à JEMED que « Tout ce qui est fait doit prendre en compte les sécheresses, sans quoi cela ne nous intéresse pas ». En effet, les grandes sécheresses deviennent plus fréquentes, probablement à cause des changements climatiques. Entre 1973 et 2000, il n’y a eu que deux grandes sécheresses. Depuis l’année 2000, trois épisodes majeurs de sécheresse ont touché l’ensemble du pays, et il y a eu une sécheresse locale. Les sécheresses ont des conséquences dévastatrices sur les populations et leur environnement, obligeant les éleveurs à s’adapter. Des pratiques autrefois impensables pour un éleveur, telles que le déstockage (vente du bétail avant la sécheresse), ont fini par être admises et sont à présent répandues.
Points de fixation
La solution proposée par les éleveurs en 1990 est devenue le modèle pour l’ensemble du travail de JEMED dans cette région, et a été plus largement adoptée dans le département d’Abalak. Elle implique l’établissement d’un « point de fixation » sur le territoire du groupe pendant la saison sèche. Il s’agit de l’adaptation d’une pratique déjà existante, consistant à disposer d’un point d’eau pour la saison sèche. Ce « point de fixation » débute par l’aménagement d’une source qui deviendra la plaque tournante du territoire du groupe. Il s’agit généralement d’un puits creusé à la main, d’une profondeur pouvant atteindre 130 mètres. Les animaux sont utilisés pour puiser l’eau. Le fait que les éleveurs s’y rendent régulièrement fait de ce point de fixation le lieu idéal pour le développement d’autres structures physiques et sociales, telles que les soins de santé, les banques de céréales et l’éducation. Les éleveurs peuvent soit continuer à pratiquer leur mode de vie traditionnel semi-nomade, en accédant au point de fixation en fonction de leurs besoins, soit se construire une maison en dur sur place s’ils le souhaitent.
Un lieu d’opportunités
Le changement climatique a obligé les éleveurs à modifier leur alimentation de base : du lait, ils sont passés aux céréales, ce qui a augmenté leurs besoins en eau et réduit leur mobilité. Le point de fixation leur donne accès à une source d’eau permanente. Une banque de céréales sur le site permet aux éleveurs d’acheter des céréales à des prix plus bas que sur le marché. On y trouve également de petits magasins collectifs gérés par des femmes, ainsi que des banques de fourrage pour les animaux. Cela signifie que les gens vendent moins d’animaux pour s’acheter des céréales et d’autres produits de base. Ils économisent également de l’argent car ils n’ont pas besoin de se rendre au marché, parfois distant de 100 kilomètres. La sécurité alimentaire étant meilleure, la communauté est plus résiliente en période de sécheresse.
Des femmes et des hommes du groupe sont formés pour prodiguer des soins de santé de base sur le site, ce qui réduit d’autant la nécessité de se déplacer. Des écoles primaires ont été construites, avec une cantine scolaire. Quelques ménages d’accueil vivent sur le site, ce qui permet aux enfants des foyers nomades de rester sur place pour suivre leur scolarité. Des cours d’alphabétisation pour adultes sont également proposés pour les hommes et les femmes.
Bétail
La protection et la régénération des ressources naturelles peuvent se faire autour du point de fixation. Ces zones protégées servent de réserves aux ânes et aux animaux laitiers pour les périodes de sécheresse ou la saison sèche. JEMED aide ensuite les communautés à faire reconnaître juridiquement leurs droits en matière de gestion des terres, un des aspects importants de l’adaptation au changement climatique.
De petits prêts renouvelables d’argent et d’animaux au sein de la communauté permettent aux gens de diversifier leurs moyens de subsistance. Cela permet aux éleveurs d’utiliser les savoir-faire dont ils disposent déjà avec les animaux pour faire des bénéfices, dont ils se servent pour financer d’autres activités génératrices de revenus. Un certain pourcentage des crédits est accordé aux femmes afin que davantage de membres de la population exercent des activités génératrices de revenus. Des méthodes modernes d’élevage ont été introduites, comme la vaccination, le déstockage, la reproduction sélective et l’utilisation d’aliments complémentaires. Ces idées peuvent sembler simples, mais il s’agissait de grands changements pour les éleveurs. Il était important que toutes les activités soient intégrées et qu’elles soient reproduites sur la plupart des sites, avec des injections successives de capitaux qui diminuaient au fil du temps. Bien que ce cycle de projet soit prolongé, il permet aux communautés de renforcer leur résilience et de diversifier leur économie, même lors des périodes de sécheresse.
Signes de changement
Il en résulte que suite à la crise, Abrik n’a perdu que 47 pour cent de son bétail à cause de la sécheresse, contre 70 pour cent sur la plupart des autres sites où JEMED ne travaillait pas. Abrik n’a sollicité que peu d’aide d’urgence en 2010, une année de grave crise alimentaire au Niger. L’école n’a pas fermé et les femmes et les enfants avaient de la nourriture, de l’eau et du lait. Bien que les pertes de bétail aient fait du tort aux éleveurs, elles ne les ont pas anéantis, car leur économie avait été diversifiée. Ils ont pu survivre à ces deux années de sécheresse avec très peu d’aide extérieure et s’en sont relevés sans aucune assistance.
La population d’Abrik est aujourd’hui résiliente et n’a plus besoin de JEMED. Elle est devenue un exemple pour les autres, qui souhaitent l’imiter. Ce processus a été long, mais il en valait la peine. JEMED est en train de répliquer cette expérience dans d’autres communautés de la région. Le Niger est un pays où la réussite est difficile à atteindre. Pourtant, par la grâce de Dieu, JEMED continuera à aider les communautés à faire fructifier le potentiel que Dieu leur a donné.
Jeff Woodke travaille avec Jeunesse En Mission Entraide et Développement (JEMED) au Niger, en Afrique de l’Ouest. Pour plus d’informations sur ce projet, veuillez écrire à [email protected]
Développement résilient
La résilience, c’est la capacité à survivre aux chocs et aux sources de stress qui peuvent frapper votre communauté, à s’en remettre et à s’y adapter. Il peut s’agir de catastrophes soudaines (par ex. séismes, événements climatiques extrêmes) ou de changements plus progressifs (par ex. changements climatiques, VIH, hausse des prix, etc.). Une communauté qui peut apprendre et s’adapter à ces conditions changeantes est une communauté résiliente. Il est important que tout développement soit résilient.